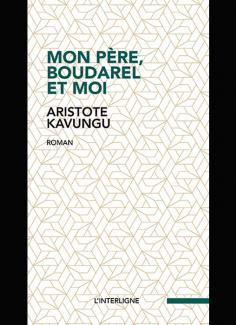Après L’adieu à San Salvador et Un train pour l’est, Aristote Kavungu publie Mon père, Boudarel et moi, un roman aussi court que dense, relatant la rencontre de l’humanité avec l’un de ses bourreaux.
Après L’adieu à San Salvador et Un train pour l’est, Aristote Kavungu publie Mon père, Boudarel et moi, un roman aussi court que dense, relatant la rencontre de l’humanité avec l’un de ses bourreaux.
Georges Boudarel a bel et bien existé. Universitaire et militant communiste, il rejoint durant la guerre d’Indochine les rangs des indépendantistes vietnamiens pour devenir responsable d’un camp de rééducation de prisonniers. Il retourne en France en 1966 à la suite d’une amnistie et y poursuit une carrière universitaire. Au début des années 1990, il est accusé de crime contre l’humanité. D’après le témoignage de nombreux rescapés du camp qu’il dirigeait en Indochine, il s’y serait livré, durant la guerre, à la torture de soldats français et aurait été impliqué dans la mort de plusieurs centaines de personnes. L’affaire Boudarel se clôt sur une ordonnance de non-lieu du fait de l’amnistie dont a bénéficié l’accusé à son retour en France. Georges Boudarel décède en 2003 à l’âge de soixante-dix-sept ans. C’est cette figure oubliée de l’histoire française que le narrateur africain de Mon père, Boudarel et moi rencontre, au hasard d’un portefeuille perdu.
Congo/Indochine
Or le père de ce narrateur a lui-même été victime de torture au début des années 1960, au Congo, prisonnier arbitraire d’un camp d’extermination pendant dix mois durant la rébellion des Simbas, qui a opposé des insurgés au gouvernement central congolais. S’il en a miraculeusement réchappé, la peur et la violence subies durant cette épreuve ont non seulement brisé une partie de la vie de cet homme, mais aussi profondément marqué son très jeune fils, le narrateur du roman, qui a très mal vécu l’humiliation de son père.
Une trentaine d’années plus tard, au début des années 1990, le narrateur, alors étudiant à Paris, trouve un portefeuille qu’il décide de rapporter à son propriétaire. Il découvre alors avec stupeur que celui-ci n’est nul autre que Georges Boudarel,
dont tous les médias parlent alors, le monstre du Camp 113. Il décide de ne rendre le portefeuille qu’à une condition, que son propriétaire lui explique pourquoi et comment un homme décide d’en torturer un autre, qu’il lui donne un début d’explication à la violence subie par des milliers de personnes qui, comme son père, ont été happés, en Afrique, en Asie ou ailleurs, par l’horreur froide et politique de camps de la mort. «En fait, en ma qualité de fils de mon père, je souhaiterais en savoir plus sur les motivations, et sur ce qu’on retire de voir les gens vomir leur douleur, implorer le pardon ou même supplier qu’on les achève.» Les deux hommes se rencontrent sur un banc parisien…
Lignes de faille
Aristote Kavungu ne tombe pas dans le piège de la «belle rencontre» dont surgiraient de profondes vérités sur la nature humaine et autres formes de vérités philosophiques. Mon père, Boudarel et moi dresse plutôt le tableau complexe et fourmillant d’une réalité humaine violente, aveugle et profondément inique, de laquelle participent autant les rires que les larmes, la douceur que les cris. L’efficacité de la narration permet à ce très court récit d’articuler en moins de cent pages différentes échelles de rapports humains constitutifs d’une organisation politique violente et hiérarchique. Ainsi se télescopent la situation d’un jeune Noir en France, société raciste dont les slogans sarkozystes sont mis en perspective avec la déception mittérandienne, le mépris d’une certaine classe moyenne africaine envers plus pauvres qu’elle, l’échec mondial des luttes communistes armées, le poids de la littérature française sur l’imaginaire des intellectuels africains, le rapport d’autorité de l’universitaire sur l’étudiant, celui du père sur le fils, de la maîtrise du langage sur la construction de l’Histoire: autant de lignes de faille, latentes et invisibles parfois, qui, en certaines circonstances humaines, tragiques et complexes, aboutissent aux morts du Camp 113 et de celui de Stanleyville.
«J’étais Africain, donc naturellement blasé»
Mon père, Boudarel et moi rappelle également, comme l’a fait récemment Blaise Ndala avec Sans capote ni kalachnikov,
que l’histoire des malheurs de l’humanité n’est pas l’apanage de l’Occident, que ce dernier n’a ni le monopole de la compassion, ni celui du recul, et que la parole de ceux qui ont vécu les pires violences politiques et guerrières n’est pas souvent la plus entendue.
J’étais Africain, donc naturellement blasé. Nous avons en tout temps des guerres de toutes sortes auxquelles l’Occident assiste sans rien faire parce qu’elles sont probablement exotiques. Et payantes.
Il y a, chez Kavungu, une forme d’humour tragique, une vitalité simple et forte, qui déloge le pire du pathos, pour mieux s’en saisir, le re-politiser, c’est-à-dire rappeler que le pire est avant tout un problème humain, non une chose fatale et lointaine. ♦