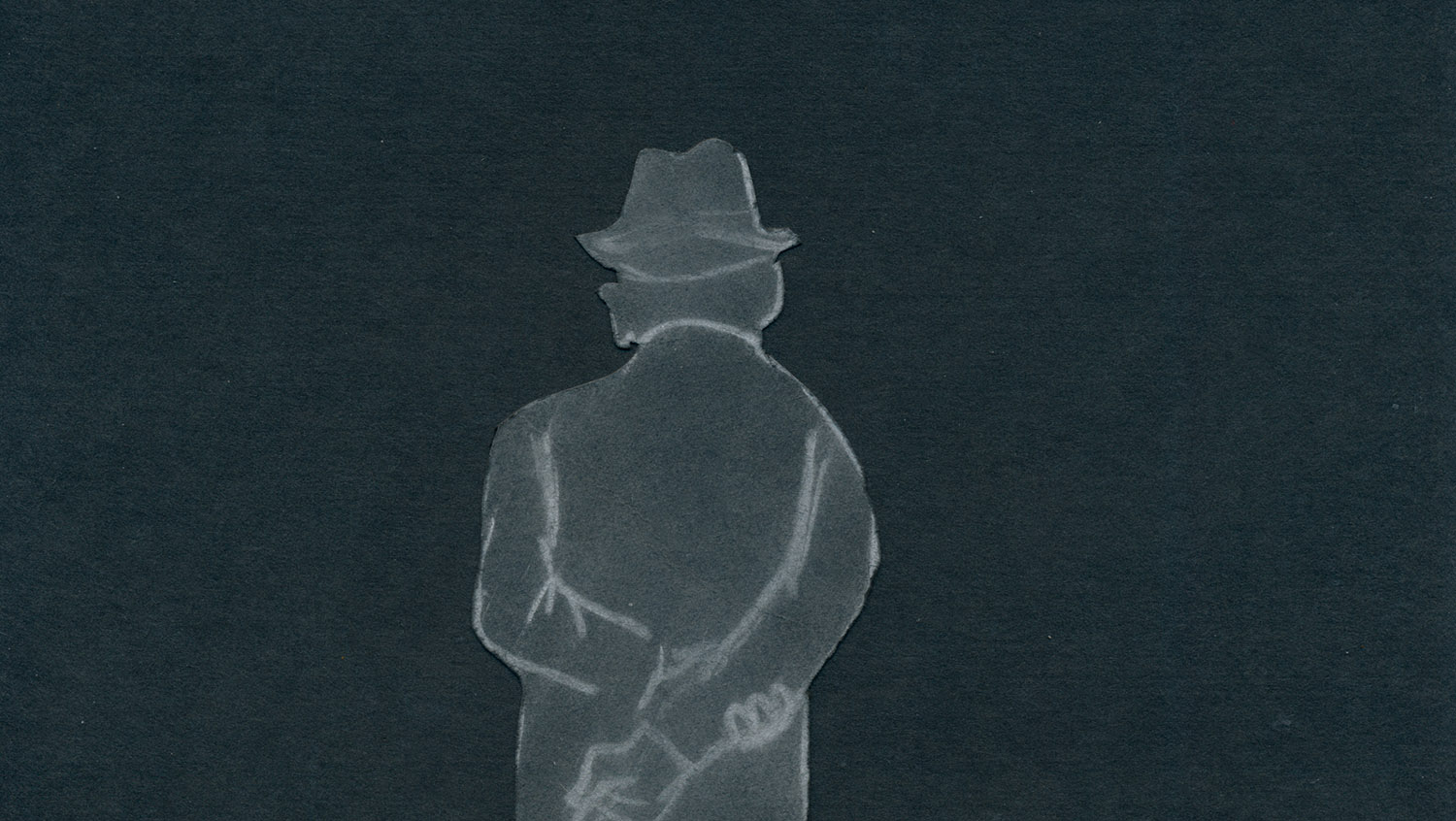 Illustration : Michel Hellman
Illustration : Michel Hellman
De son propre aveu, tout a commencé avec Federico García Lorca. Leonard Cohen a quinze ans. Il bouquine distraitement dans une librairie de livres usagés à Montréal. Voilà qu’il tombe sur un recueil de poèmes de l’écrivain espagnol, assassiné par les milices franquistes en 1936. Il parcourt l’ouvrage, lit quelques vers: «Par la Porte d’Elvire, je vais te voir passer pour surprendre tes cuisses et me mettre à pleurer1». Tout de suite, il est séduit. Il dira plus tard, dans une entrevue à la BBC2, qu’il a trouvé chez Lorca un paysage qu’il pouvait habiter.
Cette rencontre avec la poésie de García Lorca se fera sous le signe de la reconnaissance et de la correspondance. Reconnaissance, tout d’abord, parce qu’il a entendu dans la langue, à la fois lyrique et douloureuse, de Lorca, une musique qui répondait à ses intuitions secrètes. Il n’a pas cherché à imiter Lorca; plutôt, il a voulu occuper le même espace. Inspiré par lui, Cohen a cherché, dans la nature, le paysage des moments premiers où l’imagination, comme sur une toile, pouvait projeter sa lumière. L’eau, les fleurs, le sang ne sont pas des symboles, élevant notre regard vers une quelconque éternité partagée. Plutôt, ils tracent un chemin qui nous ramène au monde, un monde que, dans notre précipitation et nos égarements quotidiens, nous avions négligé et que le chant du poème descelle, décode et illumine.
Dans le premier recueil de Cohen, Let Us Compare Mythologies, publié en 1956, plusieurs poèmes résonnent du désespoir mesuré de Lorca. On y trouve les mêmes horizons clos, éclairés d’images exaltées et violentes; la même résistance face aux élans de l’histoire et à la tendresse calomniée. Dans le poème Ballad, Cohen imagine les derniers moments du Christ et, dans une langue dont le rythme et les oscillations font écho à Lorca, il réinvente, pour son propre compte, la résurrection, la naissance de l’avenir, enracinées dans la mort:
He dipped the flower / Il plongea une fleur
Into a wound / Dans une blessure
And hoped that a garden / Espérant qu’un jardin
Would grow in his hand. / Renaisse dans sa main3.
Il est difficile de ne pas songer, en lisant ces vers, à l’artiste lui-même qui, tout comme le Christ, puise dans sa propre douleur pour offrir aux autres un chemin — peut-être pas le salut, mais au moins un horizon vers lequel orienter ses regards. Si Cohen reconnaît en Lorca le lieu d’une poésie dénudée, crue, dénuée d’artifices, il y décèle aussi les correspondances qui tissent, au-delà de l’abîme des jours, les liens d’une langue commune.
Ainsi, lorsque, en 1986, on demande à Leonard Cohen de participer à un album collectif, Poets in New York, commémorant le cinquantenaire de la disparition du poète espagnol, Cohen ne se contente pas de traduire vers l’anglais le poème Pequeño Vals Vienès (Petite valse viennoise) de Lorca, il lui insuffle sa propre voix, sachant qu’elle s’élève depuis la même origine. Leurs paroles, en d’autres termes, répondent à un même appel et, dans leur rencontre, érodent les frontières du temps. Les deux poètes, à des années de distance, commentent une réalité unique, comme s’il ne pouvait y avoir qu’une seule langue, accueillie sur plusieurs rives, comme si l’illusion du temps avait démultiplié une intuition première, l’épreuve d’une seule existence:
And I’ll dance with you / Et je danserai avec toi
in Vienna, / à Vienne,I’ll be wearing / Je porterai le masque
a river’s disguise. / d’une rivière.The hyacinth wild / La jacinthe, sauvage,
on my shoulder / sur mon épauleMy mouth on the dew / Ma bouche sur la rosée
of your thighs. / de tes cuisses.
Le maître Layton
Si la poésie de Lorca a façonné, de sa sensualité violente, les premiers élans créatifs de Leonard Cohen, le poète qui l’a guidé et dont l’imagination a alimenté ses dialogues intérieurs pendant les premières années de sa carrière a été Irving Layton. De vingt-deux ans son aîné, Layton, né en Roumanie en 1912, lui a fait découvrir le pouvoir ambigu des mots: pouvoir de conférer une nouvelle forme à la réalité; pouvoir de provoquer, aussi, et d’entailler cette réalité lorsque ses conventions, ses codes et ses normes étouffent l’invention et l’aventure de la pensée.
Une amitié profonde et durable liera les deux hommes. À Montréal, ils fréquentent les mêmes cafés et Layton sera souvent l’invité de Cohen à Hydra, l’île grecque où il a acheté une maison pour écrire. Leurs groupes d’amis montréalais comprennent surtout des artistes canadiens-anglais, mais Cohen ne se résigne pas à la réalité des «deux solitudes»: il apprend le français et se lie d’amitié avec quelques francophones, dont le sculpteur Armand Vaillancourt. La compagne de ce dernier lui inspirera la fameuse chanson Suzanne.
Cohen n’a pas la grandiloquence et la faconde de Layton, son goût de l’esbroufe, son talent pour les déclamations impétueuses. Mais à travers la relation qui se tisse entre eux, on ne peut s’empêcher de penser que Cohen admire ce maître des mots et se reconnaît dans un paysage poétique où haine et amour, côte à côte, alimentent de leur tension l’effort de l’écrivain. Surtout, Cohen est séduit par l’ironie grinçante de son aîné. Elle traverse toute son œuvre, mais nulle part n’est-elle aussi présente que dans son recueil publié en 1972, The Energy of Slaves:
Each man / Chacun
has a way to betray / trouve un moyen de trahir
the revolution / la révolution
This is mine / Voici le mien
Dans ces quatre vers, où s’étage une multiplicité de sens, le poème renonce à sa position contemplative pour devenir geste. Ce poème-métonymie, où forme et contenu s’entremêlent et se confondent, ne se contente pas de dire la trahison, il est trahison. L’ironie revêt ici un double sens. Dans un registre personnel, Leonard Cohen a souvent vécu la tentation de l’engagement (il était à Cuba en 1961 au moment du débarquement de la baie des Cochons et s’est rendu en Israël au lendemain de la guerre du Kippour), sans jamais véritablement passer à l’action. Mais au-delà de cette ambivalence, le poème interroge la valeur de la création elle-même: d’emblée distance, n’accomplit-elle pas, par définition, un déni de la réalité, quand bien même elle recherche l’intrusion de la parole et l’ébranlement du monde par les mots?
Son dialogue avec Layton traverse son œuvre poétique. Dans le poème Last Dance at the Four Penny, tiré du recueil The Spice Box of Earth, Cohen interpelle directement son ami, l’appelant par son nom de naissance — Israel Lazarovitch — et l’invitant à considérer l’épanouissement de la tradition de leurs ancêtres dans le paysage enneigé du Québec:
The snow canyoned on the twigs / La neige striée sur les brindilles
Like forbidden Sabbath manna / Comme une manne interdite du Sabbat
Cette image puissante, juxtaposant la manne — blanche — du désert biblique au désert de neige québécois évoque un autre dialogue qui a traversé l’œuvre poétique de Leonard Cohen: une conversation intime avec les textes bibliques. Parole première, mais dont l’entreprise poétique conteste le caractère sacré, elle s’est d’abord révélée à lui dans la résonance des prières qu’il avait entendues à la synagogue où l’emmenait son grand-père, le rabbin Solomon Klonitzki-Kline.
Le poète et l’invisible
Les récits de la Genèse, les prophéties d’Isaïe, dont il débattait avec son grand-père, lui ont inspiré des images saisissantes, que l’on retrouve aussi bien dans ses poèmes que dans ses chansons. À l’instar d’A.M. Klein, le poète canadien dont il admirait l’ouvrage Le second rouleau (The Second Scroll, 1951), une quête du passé modelée sur le Deutéronome, Cohen s’approprie les récits bibliques pour conférer à ses intuitions la résonance du temps et de l’histoire. Ainsi, dans la chanson Dance Me to the End of Love, Cohen emprunte au déluge, dans la Genèse, la vision d’un double retour: celui de la colombe qui, en rapportant à Noé une branche d’olivier, lui signale la réconciliation de Dieu et du monde; et celui des amants qui, dans leur rencontre, inventent leur origine et leur recueillement: «Lift me like an olive branch and be my homeward dove».
Aspiration à l’unité, la parole biblique l’a entraîné vers d’autres textes religieux: le Zohar, tout d’abord, puis le Livre des morts tibétain et les poèmes mystiques de Rumi. L’inquiétude qui oriente ses recherches puise ses racines dans un sentiment d’exil: l’être humain, séparé de son origine, est étranger au monde. Cette aspiration à l’unité, on la retrouve, par exemple, dans ce court poème tiré du recueil The Energy of Slaves:
I make this song for thee / Je crée cette chanson pour toi
Lord of the World / Maître du Monde
who has everything in the world / toi qui possèdes tout au monde
except this song / sauf cette chanson
Ici, Cohen arrime son propos à une idée centrale de la mystique juive: l’être humain n’est pas l’esclave de Dieu, il est plutôt son partenaire dans la Création. Le rôle de l’être humain est de compléter l’œuvre divine. Avec le vers «sauf cette chanson» Cohen célèbre le geste du poète, sans qui le monde demeure inachevé.
Mais si l’œuvre poétique semble parfois en accord avec l’ordre du monde et la souveraineté divine, le plus souvent, elle meurtrit l’harmonie à laquelle, ultimement, elle aspire. Cohen dépeint rarement la pureté de l’absolu de manière directe. Plutôt, il la laisse se révéler, par contrepoint, en opposition à la violence et à la déchéance. C’est pourquoi, dans l’œuvre de Cohen, le sacré et le profane s’entremêlent si souvent, formant d’étranges juxtapositions: «Tell me again when the filth of the butcher is washed in the blood of the lamb» («Raconte, encore, lorsque la souillure du boucher est lavée dans le sang de l’agneau»), dit-il dans la chanson Amen.
Cohen aimait à dire qu’il était devenu poète pour séduire les femmes. Derrière cette boutade se révèle une intention sincère: ébranler, par les mots, les images calcifiées dont il se protège pour découvrir en l’autre l’écho qui lui prêterait asile. Si le poème est dialogue, ce n’est pas seulement parce qu’il a pour vocation de provoquer le lecteur, le forçant hors de ses retranchements ou l’appelant à témoigner contre ses défaillances et son aveuglement. Pour Cohen, le dialogue est l’espace où se joue la raison d’être du poème lui-même: cheminement qui nous dessaisit de nous-mêmes, qui nous exile hors du monde et de nos plaisirs familiers, pour nous révéler, créées mais oubliées par l’imagination poétique, la possibilité de l’inconnu et la réconciliation:
Where are the poems / Où sont les poèmes
that led me away / qui m’ont éloigné
from everything I loved / de tout ce que j’ai aimé
to stand here / pour m’amener ici
naked with the thought of finding thee / nu dans l’espoir de te trouver

